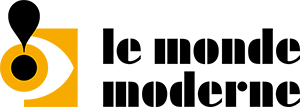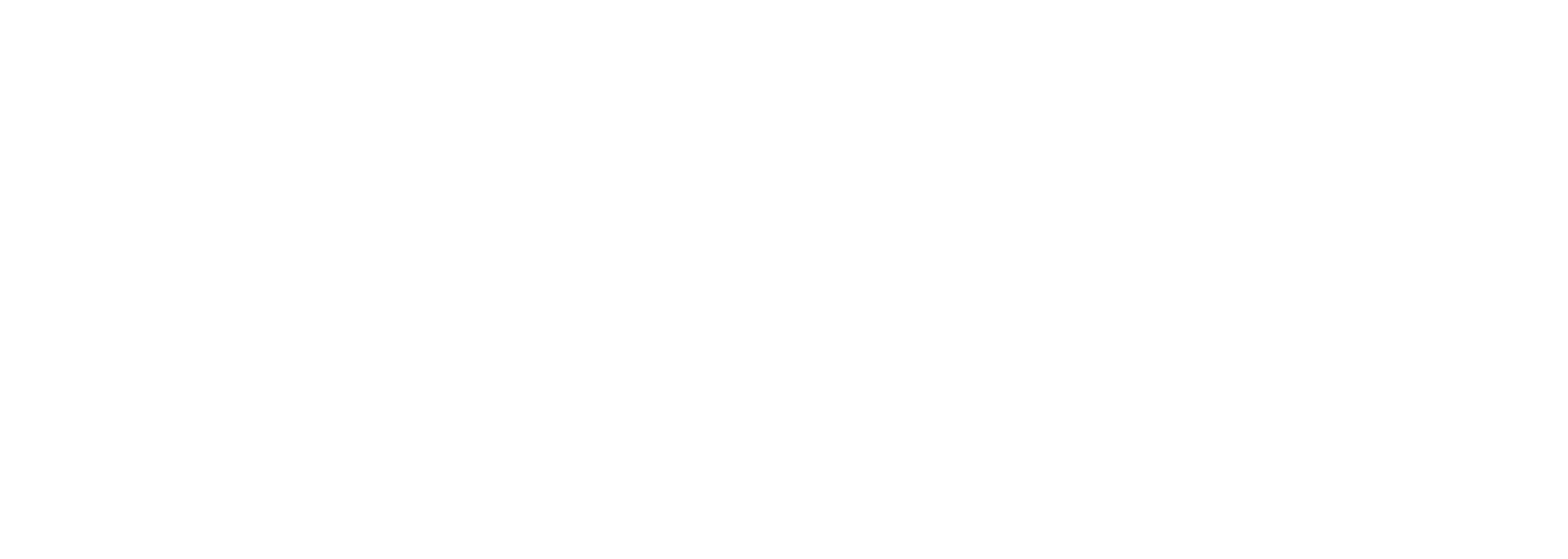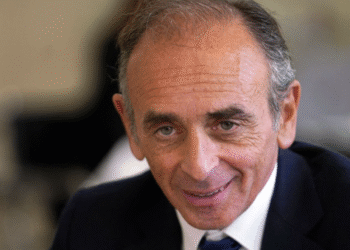Histoire et rôle géopolitique et économique du détroit d’Ormuz
Le détroit tient son nom de la petite île d’Ormuz située sur sa rive iranienne. Il permet le passage du golfe Persique au golfe d’Oman, puis à la mer d’Arabie et à l’océan Indien. Avec Gibraltar, le Bosphore, Malacca et le canal de Suez, c’est l’un des grands détroits de la planète. Il est situé sur une très ancienne route commerciale entre l’Asie, la Méditerranée et l’Europe. L’ouverture du canal de Suez en 1869 a réduit l’importance de cette route maritime, avant que l’ère du pétrole ne la rende indispensable à l’économie mondiale.
Entre la pointe montagneuse omanaise et la côte iranienne, le détroit a une largeur d’une trentaine de milles marins (55 km). Pour la sécurité du transit, deux couloirs de navigation de deux milles (3,5 km) de large chacun, l’un montant, l’autre descendant, ont été construits. Ces couloirs de navigation sont séparés par un couloir tampon de deux milles. Ces rails de navigation sont considérés comme étroits pour les supertankers, pour les porte-conteneurs ainsi que pour les méthaniers.
Bien que contestée à l’époque contemporaine par les États qui entendent lui substituer celle de « golfe Arabique », l’appellation « golfe Persique » remonte à l’Antiquité. Elle rappelle la présence de l’État perse sur la rive septentrionale. Sur la rive sud, qui passera ensuite en partie sous l’autorité très lointaine de l’Empire ottoman, cohabitent alors de minuscules émirats et sultanats rivaux, dont la pêche perlière et la piraterie sont les ressources principales.
Au XIXe siècle, les Britanniques imposent leur autorité sur cette « Côte des Pirates ». Ils établissent des protectorats de Mascate à Ormuz, de Dubaï à Bahreïn et à Koweït. C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que la région du Golfe devient le cœur pétrolier de la planète, en matière de réserves et de production de pétrole, puis de gaz. Dès lors, le détroit d’Ormuz est une artère vitale pour l’exportation des hydrocarbures de cinq des plus gros producteurs mondiaux (Arabie saoudite, Iran, Irak, Émirats arabes unis, Koweït).
Quand les Britanniques se retirent, entre 1961 (Koweït) et 1971 (les Émirats et Oman), la sécurité est déjà largement assurée par les Américains qui ont conclu avec l’Arabie saoudite, dès 1945, un accord de « protection américaine contre pétrole saoudien ». À partir de 1973, Washington déploie la « politique des deux piliers » de la sécurité des approvisionnements pétroliers de l’Occident, qui repose sur l’Arabie saoudite et l’Iran puis confie au shah d’Iran le rôle de « gendarme du Golfe ».
Lors du choc pétrolier de 1973, le Golfe représentait plus de 35 % de l’approvisionnement pétrolier mondial, réparti en proportions comparables entre l’Europe, les États-Unis et le Japon. L’Europe a diversifié ses fournisseurs mais reste néanmoins dépendante de cette voie d’accès tandis que les États-Unis, devenus exportateurs nets de brut et de produits raffinés grâce à leur production de pétrole de schiste, ne sont désormais plus dépendants du Golfe, lequel ne représente plus que 7 % de leur consommation. De son côté, l’Asie orientale reste très dépendante du détroit d’Ormuz.
Sous le régime impérial comme pour la République islamique après la révolution de 1979, Ormuz devient alors à la fois une ressource et un enjeu de la puissance iranienne. Téhéran a renoncé en 1970 à revendiquer sa souveraineté sur l’émirat de Bahreïn. Mais le 30 novembre 1971, deux jours avant la proclamation d’indépendance des Émirats arabes unis, les troupes iraniennes s’emparent de trois îlots du détroit d’Ormuz : Abou Moussa, qui dépend de l’émirat de Sharjah ; la Grande et de la Petite Tomb, qui appartiennent à l’émirat de Ras al-Khaïmah. Le contentieux lié à la souveraineté sur ces îlots court toujours. Téhéran y a installé des contingents de la force maritime des Gardiens de la révolution.
Aucune convention internationale ne réglemente le détroit d’Ormuz, qui est donc régi par le droit coutumier, et par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite convention de Montego Bay. Ce traité international, négocié en Jamaïque en 1982, est entré en vigueur en 1994 et est actuellement ratifié par 162 États, dont Oman. Les États-Unis ne l’ont pas signé. Les Émirats arabes unis et l’Iran l’ont signé, mais ne l’ont pas ratifié.
Cette convention internationale étend la largeur des eaux territoriales des États de 3 à 12 milles marins (environ 22 km). Les eaux d’Ormuz se retrouvent dès lors juridiquement partagées entre le sultanat d’Oman et la République islamique d’Iran. Téhéran et Mascate y exercent donc chacun leur souveraineté. Ce bon voisinage peut surprendre, puisque le sultanat d’Oman s’est placé depuis 1970 sous un double parapluie militaire américano-britannique. Mais il résulte du réalisme du sultan d’Oman, à la tête d’un petit État de 7 millions d’habitants dont la localisation est éminemment stratégique.
Ces eaux territoriales sont ouvertes au « passage en transit ». L’Iran ne peut fermer unilatéralement le détroit, en vertu du droit coutumier. Washington, non signataire de la convention de Montego Bay, ne reconnaît pas l’extension des eaux territoriales à 12 milles, et affirme donc que les voies de circulation du détroit d’Ormuz sont des eaux internationales. Les contentieux géopolitiques entre les États-Unis et l’Iran peuvent dès lors prendre une dimension juridique autour d’Ormuz.
Un tiers des hydrocarbures transportés par tankers dans le monde et un quart du gaz naturel liquéfié transporté par méthaniers transitent par ce détroit, soit, en moyenne 21 % de la consommation mondiale de pétrole équivalant à 20 à 30 millions de barils par jour.
Le détroit connaît aussi un important trafic transversal, rarement pris en compte. Le principal port iranien du détroit, Bandar Abbas, 500 000 habitants, n’a qu’une profondeur limitée qui ne permet pas l’accostage de grands navires. Les cargaisons (y compris d’hydrocarbures) doivent donc être transbordées dans les ports des Émirats arabes unis au départ comme à l’arrivée. Ce à quoi s’ajoute un intense trafic de contrebande au départ d’Oman et des Émirats (Dubaï surtout) vers les côtes iraniennes, pour des marchandises de toute nature, y compris sous embargo international.
Événements clés dans l’histoire du détroit :
Années 1980 : « Guerre des pétroliers » : Pendant la guerre Iran-Irak, les deux camps ont attaqué des pétroliers traversant le détroit, entraînant des escortes navales américaines et des confrontations directes.
2008 : Incidents navals : Accrochages tendus entre vedettes iraniennes et navires américains, illustrant les risques permanents d’escalade accidentelle.
2015 : Saisie du Maersk Tigris : Des patrouilleurs iraniens ont tiré des coups de semonce et saisi un navire commercial, provoquant l’intervention de la marine américaine.
2019 : Attaques de pétroliers : Deux navires ont été attaqués près du détroit dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran.
Mai 2022 : L’Iran a saisi deux pétroliers grecs, probablement en représailles à la confiscation de pétrole iranien par la Grèce et les États-Unis.
Avril 2023 : L’Iran a saisi un pétrolier à destination des États-Unis, vraisemblablement en réponse à la saisie par les États-Unis d’un navire chargé de pétrole iranien près de la Malaisie.
Avril 2024 : Quelques heures avant une attaque de drones et de missiles contre Israël, les Gardiens de la révolution iraniens ont saisi un porte-conteneurs lié à Israël près du détroit.