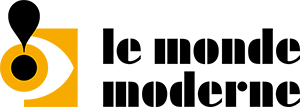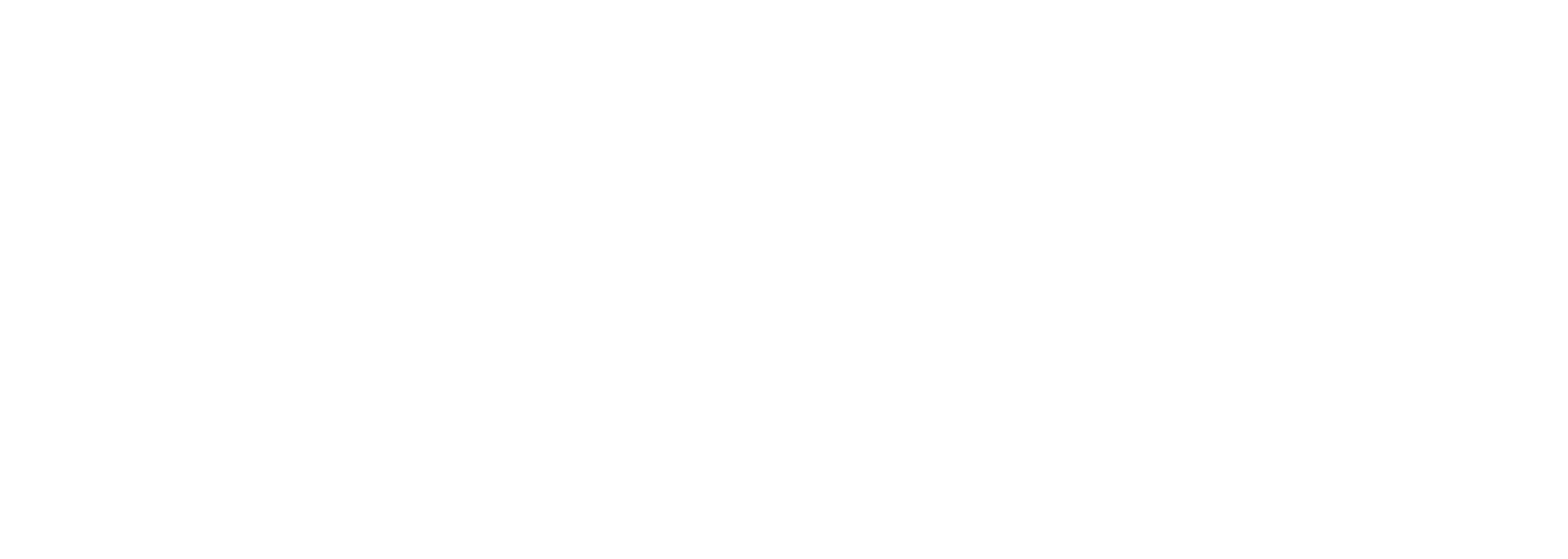L’urgence écologique ne doit pas être un prétexte pour des lois liberticides
Que l’activité humaine ait un impact sur le réchauffement est désormais une idée globalement admise, enfin !
L’urgence climatique conduit donc à l’urgence de réduire l’empreinte des activités humaines, c’est judicieux. Ça l’aurait été bien plus encore il y a 20 ans, les décideurs d’hier, sénateurs d’aujourd’hui, auraient pu proposer d’autres options, quand la recherche de la croissance à tous crins faisait taire les velléités vertes des électeurs, quand le nucléaire ne souffrait pas la contradiction, quand il fallait «assouplir l’emploi» et préparer le code du travail au développement des Ubers et autres Ryanairs. Il aurait fallu ne serait-ce que tenter de freiner la course à la surconsommation et à la surproduction, cesser de produire pour jeter, et donc au passage remettre en question le guide suprême, l’indicateur unique, la croissance du PIB.
Mais c’est aujourd’hui que les propositions se bousculent : 110 km/h sur autoroutes, limitation de l’utilisation de l’avion, fin de l’internet illimité… certains préconisent un système de crédit carbone, qui vous donnerait des points de vie. Ça se précipite ; le réchauffement climatique doit être combattu là, maintenant, par tous les moyens, le peuple semblant prêt à tous les sacrifices pour enrayer la destruction de notre planète, de l’habitat de nos enfants. De remise en question de l’indicateur unique, en revanche, toujours pas trop d’écho…
Le débat sur l’acceptation de la perte de libertés individuelles pour l’intérêt général est ouvert, chacun réagissant en fonction de sa sensibilité et de son sens commun
Il faudra faire des sacrifices… pourquoi pas ? On s’accorde à dire que le meilleur moyen de limiter l’impact de l’activité humaine, c’est de freiner cette activité, d’où ces propositions visant à enchérir les billets d’avion ou l’accès à internet. Logique, jusqu’à décembre 2019. Depuis, ça n’est plus l’urgence, mais on continue à faire comme si. Comme si on refusait de voir que la donne a changé, que l’indicateur unique s’affole, dans le rouge.
Cette croissance du PIB que l’on a cherchée comme le Graal, cette croissance forcée responsable de l’échauffement environnemental, cette croissance qu’on voudrait aujourd’hui orienter vers le vert, elle n’existe plus. Nous sommes en récession mondiale : en d’autres termes, en décroissance. Et cette récession est installée, elle va s’amplifier et durer. On aurait pu mettre en œuvre il y a 10 ans toutes les politiques restrictives proposées aujourd’hui qu’on n’aurait pas obtenu une baisse de croissance (donc une baisse des émissions de CO2) telle que celle que nous impose l’aiguillon Covid-19.
Pourtant, les responsables politiques et économiques continuent de nier l’ampleur du tsunami économique dont on n’a vu encore que la première vague et ce faisant, on veut contraindre notre économie nationale pour montrer l’exemple écologique au reste du monde. Ça vaudrait le coup, si c’était efficace. Mais faire baisser l’usage de l’avion de force, par la loi, quand le secteur va de toute façon voir son activité diminuer de 25 à 50%, c’est désormais hors sujet.
Pourtant, dans un monde en récession profonde, les menaces écologiques sont décuplées : l’urgence a changé, et nos politiques, toujours en retard d’un train de péniches, ne veulent pas le voir.
L’idée ici n’est pas de nier l’urgence climatique, mais d’affirmer que la récession va nous forcer à des sacrifices bien plus efficacement que le bâton et qu’il serait sans effet de l’accompagner dudit bâton. On lutte contre le CO2 mieux que jamais depuis le début de cette année, de ce côté-là, on peut cesser la flagellation.
Il existe une urgence écologique, une question centrale qui va venir nous cueillir dans les mois qui viennent : le traitement des déchets
En 2018, la production mondiale de déchets était de l’ordre de 2 milliards de tonnes par an ; un rapport* de la banque mondiale alertait, on se dirigeait vers une augmentation de 70% de cette masse en 30 ans et c’était un problème majeur. L’effondrement économique mondial que l’on continue de manière irresponsable à sous-estimer va mécaniquement entraîner une baisse de la production de déchets. Mais elle va dans le même temps entraîner des faillites en cascades, partout dans le monde. Ces difficultés économiques vont par effet domino toucher une grande partie des secteurs, celui du ramassage et du traitement des déchets n’y échappera sans doute pas. On a pu voir ces 20 dernières années comment «les poubelles» pouvaient très vite devenir localement un violent casse-tête, une véritable horreur environnementale, à cause de budgets insuffisants ou mal utilisés (l’exemple de la Sicile est dans tous les esprits). Et cela en pleine période de croissance, bien avant la récession.
Le véritable défi environnemental, c’est de garder la capacité de traitement des déchets quand des entreprises qui en ont la charge feront faillite. Ces faillites semblent impossibles en France ? Admettons, pour ne froisser personne, que ce scénario d’appauvrissement de la filière ne touche que d’autres pays moins solides que l’hexagone : même si leur volume global baisse, que deviendront les déchets s’ils ne sont pas traités ? Comme dit le meme du moment, la question elle est vite répondue : ils se retrouveront en mer et dans des décharges sauvages à ciel ouvert, en finissant de tuer la faune et la flore marines et en créant une pollution des nappes phréatiques et des conditions épidémiques idéales. Aujourd’hui, dans les pays développés, 35% des déchets sont traités, 4% dans les pays pauvres. Si cela devenait 0% dans les pays pauvres et 10% dans les pays riches, ce serait juste l’enfer sur Terre, l’impact climatique serait violent. Tu veux rester là à cramer comme un crevard et à baigner dans des emballages poisseux, ou tu viens avec moi to the moon? Bisous
Ce scénario de l’accumulation et du déversement sauvages de déchets est plus que probable, il devrait sauter aux yeux des écologistes de tous poils. Anticiper ce qui va se passer, sécuriser cette filière, pour que le chaos économique n’entraîne pas une catastrophe écologique et sanitaire d’une ampleur inédite, voilà l’urgence. En 20 ans, la banque mondiale a débloqué 4,7 milliards d’euros pour développer des programmes de traitement des déchets. Au regard des milliers de milliards que les banques centrales «impriment» en ce moment, c’est une goutte d’eau. C’est là que l’Europe va avoir besoin de mettre des fonds à moyen terme, beaucoup si ça n’a pas été anticipé.
Alors, bien sûr, l’économie repartira de plus belle bientôt, et il est primordial de réfléchir dès aujourd’hui à la croissance que l’on voudra à ce moment-là et aux indicateurs susceptibles de guider nos politiques mieux que l’unique référent PIB qui conduit dans le mur. Mais il n’apparaît pas pertinent de présenter au vote des mesures liberticides dans la précipitation, à un moment où l’effet de ces mesures se diluerait dans celui, énorme, de la crise.
Si on laisse faire ça, pour rien, on aura contraint le peuple à se souvenir qu’il est petit, qu’il n’a pas à découvrir le sable blanc du Pacifique, qu’il n’a pas à avoir accès à internet quand il veut (avec toutes les méchancetés qui s’y disent, ça ne peut que le sauver) que son horizon c’est : recherche de boulot, métro, dodo, et 2 semaines au camping des flots. Ce peuple, se rend-il compte que la lutte anti-émissions en question, il va la mener tout seul ? Que les barrières seront financières, et qu’ainsi ces lois restrictives auxquelles beaucoup se résignent ne concerneront jamais les plus pollueurs, ceux qui prennent leur jet ou leur yacht pour un déjeuner à Palma ou Ajaccio ? On ne parvient déjà pas à avoir une justice qui fasse démentir le vieux constat de La Fontaine, «selon que vous serez puissant ou misérable», sûr qu’on n’aura jamais une règle carbone nous contraignant tous de la même manière.
Dès lors, nous ne devons pas laisser nos dirigeants politiques s’appuyer sur notre sentiment de culpabilité pour nous imposer un recul technologique et une perte flagrante de libertés qui n’auraient plus d’effet significatif en termes environnementaux, récession aidant. Le très populaire Manuel Valls, alors Premier Ministre, a affirmé «la sécurité est la première des libertés, c’est pourquoi d’autres libertés pourront être limitées». D’aucuns, pleins de bonne volonté climatique, reprennent à leur compte aujourd’hui cette assertion Orwellienne ; Friedrich Hayek affirmait lui «Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux».**
De la pensée de Manuel Valls ou de Friedrich Hayek, laquelle l’histoire retiendra-t-elle ? Ça se joue aujourd’hui, refusons les décisions anti-sociales et liberticides, gardons les idées claires et prenons en compte les nouvelles urgences écologiques, cessons de nous mettre la tête dans le sable en niant une récession d’une ampleur inconnue depuis 1929.
Plutôt que de nous précipiter vers le chat à 9 queues de la pénitence, comprenons comment quelques malheureuses semaines de pause dans l’activité peuvent conduire à un effondrement des économies mondiales, et pourquoi nos systèmes supposés se consolider, puisqu’en croissance depuis 50 ans sont aussi peu résilients. Cela conduit à étudier le système monétaire et à remettre en question son fonctionnement (création monétaire par la dette avec intérêts, absence de monnaie de réserve mondiale), dont on sait qu’il concentre les richesses, conduit inévitablement à des crises cycliques de plus ou moins grande ampleur en même temps qu’il décrète la croissance obligatoire. Commençons par traiter les causes avant de soigner les effets avec des potions d’apprentis sorciers, réfléchissons avant de promulguer des lois liberticides dont on sait désormais que même décrétées provisoires, elles ne s’effacent jamais.
*Etude banque mondiale, déchets, 2018
**F. Hayek, «Les routes de la servitude» 1944. Cette phrase est souvent attribuée à Benjamin Franklin, à tort ; ce dernier a écrit, en 1755 : «Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité» et c’était dans un tout autre contexte que celui des libertés individuelles. Hayek, comme d’autres, a repris cette fulgurance à son compte près de 2 siècles plus tard.