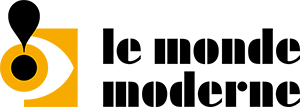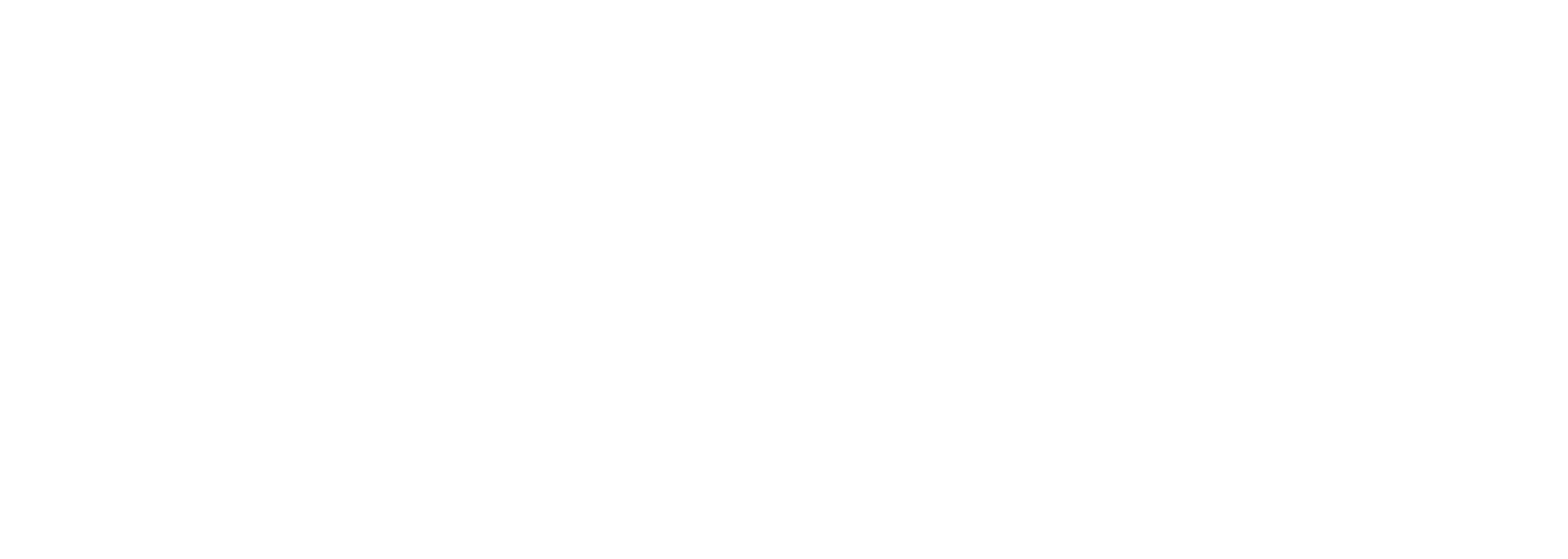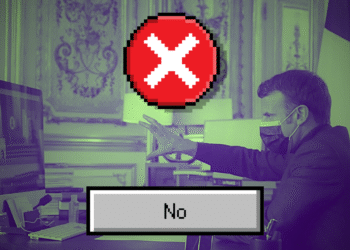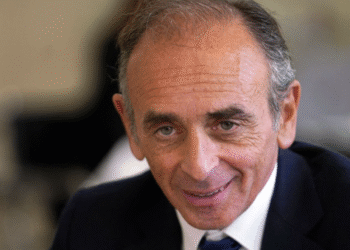L’Union Européenne est-elle une utopie réactionnaire ?
par Joseph Presti
Les dernières élections européennes auraient dû être l’occasion pour les institutions, fraîchement «renouvelées», d’acter des décennies d’échecs de politique libérale et de travailler à une Europe sociale liant prospérité et démocratie. Cependant, deux faits politiques majeurs ont marqué le mois de septembre, mettant fin à tout espoir de renouveau et confirmant la consolidation de la construction européenne autour du dogme libéral-conservateur.
Dès le 10 septembre, Ursula von der Leyen, future présidente de la commission européenne, a proposé de redéfinir l’intitulé du portefeuille «Migrations, affaires intérieures et citoyennes» en commissariat en charge de «protéger notre mode de vie européen». Les termes choisis posent question : l’utilisation du mot «protéger» sous-entend que le mode de vie européen est en danger, alors même que l’expression reste à définir, tant la définition d’un mode de vie commun aux pays européen reste un ensemble vague ou conceptuel, qui prête à débat.
Malgré un revirement encore possible, ce choix sémantique désarçonne et représente une concession idéologique faites aux droites identitaires.
La seconde polémique a été le vote, par le Parlement Européen, de la résolution sur «l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe» . Ce texte est aussi confus que contradictoire. Censé prémunir l’Europe face à la montée de la «vague brune», il s’autorise une réécriture de l’Histoire. La résolution fait l’amalgame entre les régimes totalitaires d’Hitler et de Staline et le courant de pensée communiste. La résolution s’attaque ainsi à la réécriture des événements à l’origine de la Seconde Guerre Mondiale. Elle identifie comme événement déclencheur de la Seconde Guerre Mondiale la signature de l’accord germano-soviétique. Ce choix temporel interroge. Pourquoi ne pas retenir la crise économique de 1929, la signature du Traité de Versailles ou encore la signature des accords de Munich en 1938 ? Ce choix est-il fait pour dédouaner les libéraux et leur responsabilité quant à la montée de la haine en Europe ?
Une résolution qui veut révolutionner l’Histoire européenne
Comment ne pas condamner les massacres perpétrés par les régimes totalitaires ? Il est donc tout à fait normal qu’elle s’attaque à leur idéologie et à leurs symboles. À une condition, que cela soit suivi d’actes politiques visant à réellement faire barrage à la montée des droites extrêmes en Europe. Hors, la priorité au sein de l’Union Européenne semble être de travailler à la censure des courants alternatifs au libéralisme, représentés par la gauche anti-austérité, comme le communisme. Le Parlement Européen insinue dans la résolution que les régimes totalitaires et la pensée communiste développée par Marx, sont semblables alors que cette dernière s’oppose frontalement aux principes de l’idéologie néolibérale et au fascisme. Elle ne peut être tenue pour responsable du détournement qui en a été fait par les régimes totalitaires, comme celui de Staline.
Ce qui se joue avec cette résolution est la survie et l’héritage, dans la mémoire collective européenne, d’un courant de pensée politique et philosophique, qui propose une voie différente à l’idéologie libérale dominante. En effet, quelle approche sera adoptée pour les symboles communistes ? Risquons-nous de voir disparaître les rues et monuments à la mémoire de Karl Marx ? Sera-t-il encore possible de lire Le Capital ou d’enseigner le rôle des communistes pendant la Résistance et la Libération ou seront-ils effacés de l’Histoire ?
Alors que la poussée identitaire et nationaliste se fait pressante, et que des résolutions ont déjà été prises dans ce sens (adoption par le Conseil le 28 novembre 2008 du texte Lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie), une forme de résignation s’installe en Europe. Comment croire aux belles paroles de la résolution lorsqu’on se rappelle la gestion calamiteuse de la crise de la zone euro ou encore l’incapacité de l’Union Européenne à faire respecter les valeurs fondamentales, qu’elle s’est engagée à défendre ? Sans oublier les hypocrisies des chefs d’État «progressistes» qui ont instrumentalisé les débats sur l’accueil des migrants au niveau national, en défendant des valeurs humanistes au niveau européen.
L’Europe ne devrait-elle donc pas s’alarmer de la multiplication des discours haineux et du terrain gagné par les droites dures voire extrêmes ? D’autant plus que cette parole est portée par des personnalités légitimes et crédibles aux yeux des responsables européens (Boris Johnson, Sébastian Kurz, Viktor Orbán, etc). En toute connaissance de cause, l’Union Européenne s’en accommode et la banalise, car ces droites extrêmes ne remettent pas en cause l’ordre libéral, contrairement aux pensées alternatives portées par les gauches anti-austérité.
Cette censure idéologique à travers la réécriture de l’Histoire, n’est que le prolongement de la politique de marginalisation, déjà bien entamée, que subissent les idées sociales depuis la construction de l’Union Européenne autour du dogme libéral de l’économie de marché et de la concurrence libre et non faussée.
L’U.E. a été façonnée pour que l’idéologie libérale puisse prospérer, notamment depuis l’adoption, en 1986, de l’Acte Unique Européen. Pour parfaire son projet, l’U.E. a codifié son organisation, notamment par la signature de traités et d’accords commerciaux ou par la création d’institutions de contrôles comme la Banque Centrale Européenne (B.C.E.) dont l’objectif est la maîtrise de l’inflation et non la croissance ou le plein-emploi. La B.C.E. est en charge de la politique monétaire, qui, avec l’adoption de l’euro impose la pratique de «l’austérité permanente» pour tous les européens. Cependant, bien qu’elle soit indépendante des États, elle ne l’est pas des marchés financiers. Depuis le 22 janvier 2015, la B.C.E. est obligée d’intervenir sur les marchés, par une politique monétaire expansive de «Quantitative Easing» et éviter ainsi l’effondrement des marchés financiers.
Depuis Thatcher, «There is not alternative»
L’Europe, par ses choix et son montage technocratique, adopte une attitude souvent jugée anti-démocratique en s’affranchissant de la volonté de ses citoyens. Les accords et les institutions, en plus d’assoir la domination de l’idéologie libérale, ne permettent pas aux courants alternatifs au libéralisme et contre l’austérité économique de s’exprimer.
Cette attitude a été particulièrement violente contre le peuple grec, depuis la crise de la zone euro en 2010, notamment lorsqu’en 2015 les dirigeants de l’UE imposent à la Grèce d’Alexis Tsipras un nouveau plan de «sauvetage», moyennant davantage d’austérité et de réformes dites «structurelles» (retraites, marché du travail, etc.). Cela a été imposé malgré le «non» des grecs à 61 % au référendum organisé sur le sujet quelques jours plus tôt. Cependant, les grecs avaient-ils vraiment le choix ; alors que dès la victoire de Syriza en janvier 2015 le président de la Commission Jean-Claude Juncker avait déclaré au Figaro : «Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens».
Pour imposer ses choix, l’Union Européenne n’a pas hésité à menacer la Grèce de sanctions économiques, voire d’envisager une sortie de la zone euro. Cette période a, de plus, été source de grande instabilité mais les dirigeants européens ont préféré risquer un éclatement de la zone euro, plutôt que faire une concession idéologique.
Peu importe, en somme, ce que décident les peuples, il faut poursuivre le projet (libéral) européen et ce, quel qu’en soit le prix. Le peuple grec en paie encore les conséquences politiques, économiques et sociales.
Ce jusqu’au boutisme européen n’a fait que renforcer le sentiment de trahison et d’abandon des citoyens et citoyennes dans les institutions nationales et européennes. En Grèce, cela a conduit en 2019 le gouvernement Tsipras à organiser des élections anticipées, qu’il a perdues, au profit de la droite conservatrice et libérale. Le gouvernement «très» conservateur de Kyriákos Mitsotáki s’est fait remarquer dès son intronisation en fermant des squats, où étaient notamment accueillis des migrants au motif que ces lieux étaient «infestés de terroristes». Déjà en 2017, le nouveau Premier ministre grec, en comptant deux anciens membres du parti d’extrême droite Alerte populaire orthodoxe (Laos), s’attaquait à l’asile avec le vote de la loi «omnibus». Cette loi supprime l’«asile universitaire», interdiction faite aux forces de l’ordre de pénétrer dans les facultés, mesure héritée des soulèvements étudiants contre la dictature des colonels.
L’exemple italien est également symptomatique de l’attitude de l’U.E. L’Europe ne s’est jamais réellement investie auprès de l’Italie sur la question de l’accueil des migrants, et a été silencieuse lors du vote du décret-loi «Immigration et sécurité» en 2018. Cependant, elle n’a pas hésité à rejeter le budget italien et à médiatiser «l’irresponsabilité financière» de l’Italie.
Le 20 mai 2018, Bruno Le Maire, ministre de l’économie français, avait déclaré : «Chacun doit comprendre en Italie que l’avenir de l’Italie est en Europe et nulle part ailleurs, et pour que cet avenir soit en Europe, il y a des règles à respecter». Et de poursuivre : «Les engagements qui ont été pris par l’Italie valent, quel que soit le gouvernement». Ou encore l’intervention du commissaire européen au budget, Pierre Moscovici, suite au refus italien de revoir son budget 2019 : «Je souhaite un dialogue mais des sanctions pourraient être finalement imposées si nous ne parvenons pas à un accord», déclaration qui fait comprendre qu’une alternative à la politique libérale est impossible. Le maître mot étant la «rigueur».
L’intransigeance européenne et les menaces de sanctions ont cependant fait le jeu de Matteo Salvini, leader du parti d’extrême droite la LEGA. Ce dernier a eu tout le loisir de dénoncer l’ingérence européenne sur les choix nationaux «Encore une invasion de terrain inacceptable» et de remporter quelques mois plus tard les élections européennes.
Il existe donc pléthore de mesures de rétorsions inscrites dans les traités (Maastricht, Lisbonne, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance) sanctionnant un partenaire ne respectant pas les règles budgétaires et la suprématie des marchés. Cela voue à l’échec toute politique anti-austérité portée par la gauche. Ses propositions ne sont pas inscrites à l’agenda européen et les victoires électorales se transforment rapidement en défaites politiques, faute de pouvoir mener à bien un programme d’investissement social. De plus, le discours de gauche est devenu inaudible notamment par son incapacité à s’affranchir des règles européennes et à clarifier sa stratégie, au gré des alliances contre-nature et des échecs électoraux.
L’intransigeance de l’Europe lorsque les critères budgétaires ne sont pas respectés, contraste, par sa fermeté et sa violence, avec l’attitude conciliante envers les pays ne respectant pas les valeurs fondatrices européennes qui ont façonnées la construction européenne. Le «principe de solidarité», qui a tant fait défaut lors de la crise migratoire et lors de la crise de la zone euro, est pourtant central car cité dès la cinquième phrase de la déclaration fondatrice du 9 mai 1950 de Robert Schuman «L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait».
L’Union Européenne fait-elle le jeu de l’extrême droite ?
Le vote de la résolution par le Parlement Européen semble donc n’être qu’une lettre de bonne conduite à l’attention de l’extrême droite, sans effets politiques. Il est au mieux un prolongement de l’article 2 du Traité sur l’Union Européenne (TUE),
«L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’Homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes».
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506 fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF
Pour s’en convaincre il suffit d’analyser les cas polonais et hongrois, symptomatiques de l’impuissance européenne et de sa passivité.
La Hongrie, depuis l’arrivée de Viktor Orbán au pouvoir, s’est distinguée par l’adoption d’une série de mesures liberticides, anti-démocratiques et libérales. En 2011, un texte introduisant des références aux racines chrétiennes et interdisant le mariage entre personnes homosexuelles est voté. En 2013, un amendement dépossédant la Cour Constitutionnelle d’une grande partie de ses pouvoirs est voté. Le Premier ministre hongrois abaisse entre autres l’âge de départ à la retraite des juges, ce qui a pour effet d’envoyer un dizième d’entre eux en retraite anticipée. Quelques mois plus tard, il instaure la détention provisoire illimitée. Viktor Orbán fait fermer les frontières de son pays puis refuse de participer au programme de «relocalisation» devant répartir l’accueil des exilés et soulager l’Italie et la Grèce, plus exposées. La construction d’un mur à sa frontière avec la Serbie, achevé samedi 29 août 2015 pour empêcher l’entrée des migrants, limite de fait la libre circulation des personnes.
Le gouvernement hongrois travaille à limiter la «liberté de la presse», d’abord en regroupant l’ensemble des médias publics au sein d’une structure, tout en licenciant des dizaines de journalistes. Un organe de contrôle a été créé pour surveiller les médias publics et privés. Un «conseil des médias» a été créé dont les membres sont nommés directement par le gouvernement. Ce conseil dispose d’un droit d’inspection, peut infliger des amendes et peut forcer les journalistes à révéler leurs sources sur des questions liées à la sécurité nationale. La presse d’opposition fait aussi les frais de cette politique. Le 12 octobre 2016, le principal journal de gauche hongrois, Népszabadság, n’est plus diffusé, suite à son rachat par un proche de Orbán alors que le titre avait été bénéficiaire l’exercice précédent. Le 28 avril 2018, le gouvernement hongrois s’était distingué en voulant réintroduire la peine de mort, alors que le pays a signé la Charte des droits fondamentaux de l’U.E., qui en interdit le recours. Bien que cela n’ait pas abouti, cela en dit long sur les objectifs du modèle qu’incarne Viktor Orbán.
Le gouvernement Orbán travaille aussi à revisiter le passé du pays afin d’y écrire un nouveau récit national. Il met en avant la nostalgie de la «Grande Hongrie» d’avant la Première Guerre mondiale, multiplie les gestes en direction des hongrois au-delà des frontières, et cultive une vision du pays victime de l’Histoire, malmené par les grandes puissances. De plus, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution en 2012, la «République de Hongrie» a laissé place à la «Hongrie».
Cependant, derrière un discours d’apparence protectrice tourné vers ses électeurs, Viktor Orbán poursuit une politique ultralibérale. En 2012, son gouvernement met en place des impôts sectoriels visant les banques et les télécommunications. Conséquences : les frais bancaires et les forfaits de téléphonie et d’internet en Hongrie explosent. L’impôt sur le revenu, lui, reste non progressif, à un taux fixe de 15 %, tandis que l’impôt sur les entreprises est abaissé de 19 à 9 %. L’U.E. n’a même rien trouvé à redire à la loi adoptée par la Hongrie, fin 2018, portant le nombre d’heures supplémentaires annuelles à 400 heures – 56h par semaine – et payables trois ans plus tard, appelée «La Loi esclavagiste». Alors qu’au même moment le pays manque cruellement de main-d’œuvre suite à l’exode de plus 200.000 personnes, partant à la recherche de meilleures conditions de travail.
En Pologne, l’arrivée au pouvoir du PiS (Droit et Justice) parti de droite extrême a eu les mêmes effets qu’en Hongrie. L’exécutif fait adopter, dès les premiers mois de sa prise de pouvoir, une loi pour prendre le contrôle des médias publics : la nomination comme la révocation de leurs directions deviennent une compétence du ministre du Trésor. L’audiovisuel public polonais se voit imposer une ligne éditoriale progouvernementale et plus de trois cents journalistes sont licenciés. Le gouvernement ne cesse d’attaquer verbalement la presse d’opposition et n’hésite pas à retirer des subventions à des revues de gauche, comme Krytyka Polityczna. Le gouvernement PiS refuse également de coopérer, comme la Hongrie, au programme de «relocalisation» des migrants. Le discours politique au sommet de l’État devient un discours de repli national.
Le PiS fait une croix sur tout le travail de mémoire entrepris sur la Shoah depuis les années 1990. Il remet en cause les travaux d’historiens sur l’attitude de certains polonais pendant la guerre et souhaite modifier les programmes scolaires. Il dépose un projet de loi visant à protéger la «réputation» et la «dignité» de la nation polonaise. Ce texte fait encourir une peine allant jusqu’à trois ans de prison et une amende à quiconque déclarerait publiquement que des polonais – ou l’État polonais – seraient responsables de crimes commis par les nazis ou auraient collaboré avec eux. Le Président Andrzej Duda, lors d’un discours aux représentants des musées et institutions culturelles du pays, avait demandé de «galvaniser le nationalisme polonais et de renoncer aux narratifs qui déshonoraient la Pologne». Et pourtant, l’Histoire montre déjà combien le peuple polonais a payé un lourd tribut à la barbarie nazie et combien la résistance polonaise a été essentielle dans la lutte contre le nazisme, tout comme les moyens du gouvernement en exil et l’armée polonaise libre.
Les mesures économiques semblent être davantage guidées par l’idéologie que par l’économie notamment le choix affiché de mettre les familles au premier plan, et ainsi aligner l’économie avec les valeurs catholiques du parti. Il n’est pas étonnant que 100.000 femmes aient quitté le marché du travail ces dernières années.
Ces deux exemples qui devraient interpeller les défenseurs des «valeurs communes» au sein de l’Union Européenne, ne provoquent que peu d’émois. Comment oublier qu’il a fallu 5 ans au groupe parlementaire Parti Populaire Européen (P.P.E.) dont est membre le Fidesz (parti d’Orbán) pour demander son exclusion du groupe, du bout des lèvres ?
L’Union Européenne sait donc être «forte» et «responsable» lorsqu’elle doit faire respecter les critères de Maastricht, mais elle est bien «faible» et «irresponsable» lorsqu’elle doit faire entendre sa voix et dénoncer les violations de l’État de droit.
L’U.E., elle-même, est obligée d’avouer son impuissance. Elle ne dispose pas d’outils pour sanctionner les pays coupables de dérives autoritaires et anti-démocratiques. Il existe bien l’article 7 du Traité de Lisbonne, nommé la «bombe atomique» des traités par Bruxelles. Ce texte, souvent évoqué mais jamais utilisé, prévoit en cas de non-respect par un État membre des «valeurs fondamentales» de l’Union, que le droit de vote de ce pays, au sein du conseil, soit suspendu. Son adoption requiert cependant la majorité absolue (moins le pays concerné) pour s’appliquer, ce qui aujourd’hui la rend inapplicable. Comme le disait Jean-Claude Piris, le rédacteur de l’article 7, au sujet de la procédure : «Tout le monde était d’accord pour que ce soit une procédure lourde», «Cela n’a pas été approuvé parce que certains États-membres craignaient que cela se retourna un jour contre eux le jour venu».
Preuve en est, la Commission a adopté une proposition pour activer l’article 7 à l’encontre de la Pologne, le 20 décembre 2017, et le Parlement Européen a fait de même le 12 septembre 2018, à l’égard de la Hongrie. Le résultat est loin d’être probant car aucune mesure coercitive n’a pu être adoptée.
Un double jeu trouble
Le double jeu de l’Europe fait donc les affaires des gouvernements des droites extrêmes. Et la gestion de l’accueil des migrants est un autre exemple de la défaite idéologique de l’Europe. Sujet de prédilection des droites dures, l’Europe a été incapable de s’unir et trouver des solutions. L’U.E. a «sous-traité» en partie la gestion de la crise des migrants à des pays proches des zones de migration (Lybie, Afghanistan, Turquie). L’accord signé avec l’Afghanistan, sobrement appelé «Joint Way Forward on Migration Issues» étant sûrement l’un des deals les plus confidentiels de l’U.E. Signé le dimanche 2 octobre de cette année, l’accord vise à faciliter le retour forcé des ressortissants afghans déboutés du droit d’asile. En échange, les États membres s’engagent à contribuer financièrement au développement économique et politique à hauteur de 1,3 milliard d’euros par an, jusqu’en 2020, alors même que le pays est encore en guerre.
Incapable de parler d’accueil, de dignité, d’humanité, l’Europe n’a pas hésité à répondre aux exigences des gouvernements nationalistes (renforcement des frontières, refus de la politique de répartition), tout en empruntant certains aspects de sa sémantique.
L’extrême droite aura beau dire, à qui veut l’entendre, être le premier opposant au libéralisme, ses actes la trahissent. L’obsession identitaire et l’immigration est son seul programme. L’extrême droite est sans solution lorsqu’il faut répondre aux problématiques sociales, climatiques ou voter des mesures renforçant la lutte contre l’évasion fiscale et les inégalités sociales. Par exemple, les députés du Rassemblement National votent contre ou s’abstiennent sur les lois devant «Renforcer le pouvoir des salariés», sur les «Droits des femmes et l’égalité au travail», pour «Lutter contre l’évasion fiscale» ou encore au sujet du «Socle européen des droits sociaux».
Au final, comment ne pas voir toute l’hypocrisie du Parlement Européen (P.E.) lorsqu’il vote la résolution sur «l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe» ?
Les belles paroles du texte ne tiennent donc pas la comparaison lorsqu’on fait l’inventaire de la politique et des choix de l’Europe. C’est donc naturellement que les dossiers sur lesquels les gouvernements de l’U.E. parviennent à trouver des accords sont ceux qui consolident l’austérité : pacte budgétaire de 2012 pour renforcer la surveillance budgétaire dans la zone euro, mise en place de dispositifs tels que le Mécanisme européen de stabilité pour contrôler la politique économique des États en difficulté, imposer des privatisations, et le nivellement des droits sociaux par le bas. Alors que concernant l’accueil des réfugiés, il y a eu consensus mais sur les dispositifs de surveillances des frontières de l’U.E. au prix d’accords avec la Turquie et la Libye. À l’opposé, aucun accord d’importance n’a été trouvé sur la directive des travailleurs détachés ou encore la lutte contre l’optimisation fiscale.
Pour conclure, il suffit d’analyser les scores des partis europhobes ou faisant partie de la droite extrême dans chaque pays membre, aux dernières élections européennes, pour acter l’échec de l’Union Européenne dans sa lutte contre la «haine» et la promotion de «valeurs communes».